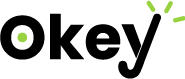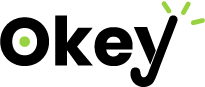Voici une carte blanche qu’Antoine Bradfer, ancien joueur emblématique du Wellington, nous adresse. Une belle réflexion qui doit être lue avec attention.
Carte blanche — Le hockey belge est à la croisée des chemins
Le hockey belge est aujourd’hui confronté à un tournant décisif. Longtemps porté par l’énergie de ses clubs et la passion de ses membres, il a connu ces dernières années une croissance sans précédent, jusqu’à atteindre une reconnaissance nationale et internationale remarquable. Mais cette ascension fulgurante a aussi fait apparaître les fragilités d’un modèle qui n’a pas su évoluer au même rythme que son succès. Nous sommes aujourd’hui à la croisée des chemins. Cette carte blanche met en abyme certaines des réalités d’un sport sous le feu des projecteurs, tiré vers le haut par une fédération ambitieuse et porté par d’énormes succès, mais dont le modèle historique de fonctionnement et de financement des clubs ne peut plus tenir la cadence. Gros plan sur les faiblesses et les enjeux du hockey en Belgique, qui doit aujourd’hui se réinventer pour répondre aux nouvelles réalités sociétales et à l’effritement des valeurs qui ont fait les lettres de noblesse de notre sport.
Un développement spectaculaire mais une identité mise à l’épreuve
Porté par des résultats exceptionnels de nos équipes nationales, le hockey belge a attiré en masse de nouveaux pratiquants. Il est devenu un sport visible, moderne, attractif. Cette croissance, accompagnée d’investissements dans les infrastructures et d’une meilleure organisation, est sans précédent dans l’histoire du sport belge. Mais ce développement rapide a entraîné une dilution progressive des valeurs fondatrices : l’esprit de club, la patience dans la formation, le sens de la communauté, l’engagement désintéressé, le fair-play.
Le hockey belge vit un paradoxe. Alors que ses équipes nationales brillent à l’international, que ses infrastructures s’améliorent, que son image publique est forte, ses clubs sont de plus en plus fragilisés. La croissance du nombre de membres ralentit, pendant que le nombre de clubs, lui, continue à croître. Cela entraîne une concurrence accrue, une dispersion des talents, une pression constante sur les clubs historiques, qui peinent à stabiliser leur base, à rentabiliser leurs investissements, et parfois même à préserver leur identité. Cette combinaison a engendré une dynamique de concurrence très directe, parfois brutale. Chaque club se bat pour attirer ou retenir des membres. On assiste à une forme de marchandisation de la relation au club, à la frontière du sport-compétition et de la stratégie marketing. C’est une spirale qui n’est plus soutenable et qui desservira probablement l’ensemble des clubs dans le temps.
Une fédération professionnalisée, mais un modèle en déséquilibre
La fédération a fait un travail remarquable de structuration. Elle s’est professionnalisée, a développé un cadre compétitif efficace, et a assuré le financement du haut niveau grâce à ses succès internationaux. Mais le coût réel de ce développement reste en majorité supporté par les clubs. Ce sont eux qui accueillent les enfants, qui forment les talents, qui mettent à disposition les terrains et les entraînements, et qui paient le gros des salaires de nos athlètes, sans réellement profiter des retombées ou des contrats de sponsoring.
Dans le même temps, les fédérations multiplient les exigences. Les intentions sont bonnes : structurer le sport, renforcer les formations, développer des outils modernes. Mais la réalité, c’est que ces injonctions, toujours plus nombreuses, reposent presque exclusivement sur des bénévoles. Des comités surchargés, des parents disponibles un soir par semaine, des passionnés qui s’épuisent. Une réalité de terrain tenable pour combien de temps ?
Derrière chaque club, ce sont toujours les mêmes bénévoles qui assurent le fonctionnement. Ils sont à la fois responsables sportifs, secrétaires, coordinateurs, cuisiniers, chauffeurs, arbitres. Ils font vivre le club à bout de bras. Mais leur nombre diminue. Leur charge augmente. Et leur motivation, naturellement, s’érode. Les clubs sont aujourd’hui confrontés à un paradoxe : on leur demande une gestion professionnelle, mais ils n’ont ni les outils, ni les ressources, ni les marges de manœuvre pour l’assumer. La base humaine du hockey belge est en train de se fissurer.
Des coûts sociaux et un cadre associatif obsolètes
Le monde associatif sportif fonctionne encore avec des outils d’un autre temps. Il est devenu impossible de salarier correctement les compétences nécessaires sans se heurter à une complexité administrative et à des coûts sociaux inadaptés. Les clubs doivent gérer des collectifs de centaines de membres, des écoles de jeunes, des événements, des plannings, des obligations légales, mais sans aucune structure de soutien viable. Aucun régime n’est aujourd’hui pensé pour permettre à un club sportif de recruter et rémunérer dignement.
Le membre devenu client
L’une des transformations les plus profondes est culturelle : le membre est trop souvent devenu client. Je paie, donc j’ai droit. Il attend une prestation, une qualité de service, une réponse immédiate à ses attentes. Il change de club si son enfant n’est pas sélectionné, compare les horaires, les prix, les coachs. Mais un club n’est pas une salle de sport. C’est une communauté. Et cette communauté ne tient que si chacun accepte d’en être acteur. La logique du consommateur détruit lentement mais sûrement le tissu associatif. Et le hockey belge en subit déjà les effets.
À l’instar du shopping médical, où un patient passe de médecin en médecin jusqu’à recevoir ou entendre ce qui lui plaît, certains hockeyeurs, dès le plus jeune âge, naviguent de club en club, à la recherche du projet parfait, sans jamais accepter d’y contribuer réellement. Les clubs, désespérément à la recherche de nouveaux membres, n’ont d’autre choix que de draguer et promettre à ces jeunes mercenaires ce qu’ils ont envie d’entendre. Ce modèle est définitivement incompatible avec la vie de club.
Ceci est évidemment lié aux précédents points. C’est bien l’arrivée en masse de nouveaux membres, l’incapacité des clubs à fédérer en suffisance, couplées à une individualisation certaine des relations humaines dans notre société, décuplée par la dernière pandémie, qui ne poussent pas les « nouveaux » à s’engager pour le club et à, de facto, se considérer comme des clients. Les sports d’équipe, au même titre que la collectivité en entreprise, sont les derniers remparts de notre société contre l’individualisme et l’isolement.
Inverser cette tendance représente un travail de fond abyssal, mais je ne vois aucune autre issue positive pour l’avenir de notre sport. Le club de hockey n’a aucun avenir si la tendance du membre nomade se poursuit. Le modèle économique actuel, déjà inapproprié à l’ensemble des coûts, ne pourra pas supporter une instabilité croissante des bases de membres qui doivent, au contraire, permettre de construire sereinement des plans de développement dans la
durée.
Une inégalité croissante de l’accès au financement public
Autre facteur de tension : les clubs ne sont pas égaux face aux aides publiques. Entre communes, entre régions, les différences sont énormes. Certains reçoivent des subsides de plusieurs millions d’euros. D’autres doivent financer des terrains avec leurs seules recettes.
Cette inégalité alimente aussi la concurrence entre clubs. Elle creuse les écarts, rend certains projets impossibles. Le problème, c’est que cela accentue des inégalités territoriales énormes. Quand un club, dans une commune bien dotée, bénéficie de plusieurs millions d’euros pour ses infrastructures, c’est tout ce qu’un autre ne pourra pas investir dans l’encadrement, la formation ou le projet sportif.
La fin annoncée du financement public massif
Dans un contexte de finances publiques tendues, le sport ne semble plus une priorité budgétaire. La tendance est à la responsabilisation des structures locales, sans véritable accompagnement. Le message implicite est clair : “débrouillez-vous”. Ce désengagement progressif n’est pas neutre. Il transfère la charge sur les clubs, tout en maintenant des exigences élevées. Et cela, sans même créer les outils pour permettre un financement alternatif.
La tendance qui se profile pour l’utilisation des deniers publics dans le développement du sport – et de beaucoup d’autres secteurs – n’est pas réjouissante. Noyé sous une dette publique qui explose et des recettes fiscales sous pression, le monde politique, par une série de mesures discrètes mais fermes, est en train de transférer la responsabilité du financement du sport vers le privé.
Le top hockey, une économie déconnectée
Le haut niveau repose aujourd’hui presque exclusivement sur le soutien de sponsors privés.
Mais il s’agit, le plus souvent, de mécénat plus que de sponsoring. Ces soutiens sont souvent dépendants d’une personne ou d’un lien affectif. Ils ne sont ni garantis, ni pérennes. Le top hockey est ainsi devenu un luxe que seuls certains clubs peuvent s’offrir. Cela crée un modèle élitiste, qui renforce les inégalités et fragilise la compétition.
Le projet sportif et les résultats de certains clubs dépendent souvent du bon vouloir – et de l’amour d’un blason – de quelques personnes. Nous ne crachons pas dans la soupe, c’est évidemment une aubaine de pouvoir compter sur la contribution de privés dans le soutien sportif des ambitions de leur club. Mais cela souligne toutefois la fragilité du modèle et son manque de durabilité.
Les clubs cannibales et la spirale du court terme
Dans un marché de plus en plus tendu, certains clubs deviennent cannibales. On recrute des enfants à 7 ou 8 ans. On promet des sélections, des opportunités, on déstabilise les projets des autres. Le travail de formation de plusieurs années peut s’évaporer sans dialogue, sans cadre, sans aucune compensation.
Et cette compétition pousse chacun à entrer dans le jeu. Même ceux qui ne le veulent pas.
C’est une spirale dans laquelle tout le monde est perdant à la fin. Si on décide de faire fi des valeurs de notre sport, de l’éthique et des relations cordiales entre les clubs, il est urgent de protéger les clubs formateurs, de réguler les transferts, d’instaurer des mécanismes de solidarité, mais surtout, de redonner du sens à l’engagement.
Or aujourd’hui, on recrute dans les cours d’école, on change de maillot à 9 ans, on débauche les entraîneurs à la dernière minute, parfois alors même qu’un engagement officiel avait été pris. Et tout cela finit par casser les dynamiques collectives qui faisaient la force du hockey.
Cette logique de court terme, de concurrence, de consommation, de fric, ne servira aucun club sur la durée. Elle fatigue les gens. Elle rend les projets plus fragiles. Et elle dénature les valeurs fondatrices de notre sport. Là où, autrefois, un respect tacite régissait les relations entre clubs, on agit désormais comme de simples concurrents dans un marché saturé et non régulé.
Malheureusement, certains clubs, avides de résultats, obsédés par la taille et les succès, sont en train – je l’espère malgré eux – de dérégler structurellement l’ensemble des valeurs, quitte à détruire l’équilibre si fragile de tout un secteur.
Reprendre le contrôle : remettre le club au centre
Il est temps de changer de regard. Le modèle doit être repensé autour du club. Cela suppose :
• De créer un statut du bénévole renforcé, et de leur offrir des outils concrets pour alléger leur charge, pour les bénévoles, les joueurs, les encadrants ;
• De protéger les clubs formateurs, avec un cadre réglementaire clair et des compensations en cas de débauchage précoce ;
• De généraliser des mécanismes de soutien privé structurés (tax shelter, coopératives locales, incitants fiscaux) ;
• De poser les bases d’une éthique partagée entre clubs, qui limite la concurrence sauvage et favorise la coopération – le sport n’en sera que plus fort à la fin ;
• De rebâtir une fierté d’appartenir à un club, une famille, un projet commun.
Le hockey belge a encore un avenir brillant. Mais il ne se jouera pas que dans les sphères de la division honneur. Il se jouera dans les clubs, tous les clubs. Dans leur capacité à tenir bon.
À se recentrer. À reconstruire, ensemble, un modèle plus juste et plus durable. Le hockey belge ne survivra pas grâce à des résultats internationaux ou des plans à cinq ans. Il survivra si chaque club redevient un lieu vivant. Où les membres ne sont pas de simples usagers, mais des piliers. Où les entraîneurs sont respectés, les bénévoles soutenus, les enfants formés avec patience, pas recrutés à l’usure.
C’est là que se trouve le vrai combat. Et c’est là que se joue l’avenir. Le hockey belge est à la croisée des chemins.
Antoine Bradfer